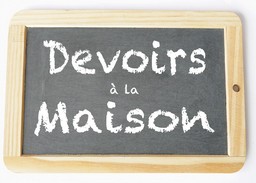
Les devoirs à la maison
Xavier de Beauchesne
La question des devoirs à la maison est, à l’école élémentaire, récurrente et rarement réglée de façon formelle. Il y quelques semaines, une équipe m’interpelait à ce propos en me demandant si l’arrivée du nouveau cycle 3 permettait de donner des devoirs aux élèves de CM1 et CM2 comme en 6ème… Les lignes qui suivent, bien loin de clore le débat, proposent quelques éléments de réflexion permettant à chacun d’organiser les devoirs à la maison de façon réfléchie.
- Rappel des textes officiels
Nous le savons tous, les textes officiels le disent, les devoirs écrit à la maison sont proscrits. Mais qu’est-ce qui est interdit vraiment. Etudions ce que disent ces textes.
Dans le premier arrêté, daté du 23 nov. 1956, la volonté de supprimer les devoirs ne laisse aucune incertitude.
“Des études récentes (…) ont mis en évidence l’excès du travail écrit, généralement exigé des élèves. En effet, le développement normal physiologique et intellectuel d’un enfant de moins de 11 ans s’accommode mal d’une journée de travail trop longue. Six heures de classe bien employées constituent un maximum au-delà duquel un supplément de travail soutenu ne peut qu’apporter une fatigue préjudiciable à la santé physique et à l’équilibre nerveux des enfants. Enfin, le travail écrit, fait hors de la classe, hors de la présence du maître et dans des conditions matérielles et psychologiques souvent mauvaises, ne présente qu’un intérêt éducatif limité. En conséquence, aucun devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne sera demandé aux élèves hors de la classe.” (B.O.E.N. n° 1 du 3 janvier 1957)
Pourtant, le texte laissant quelques ambigüités, notamment en cours préparatoire, il fallut préciser les choses. Ce qui fut fait en décembre 1964
” Je tiens à préciser que l’interdiction formelle de donner des travaux écrits à exécuter hors de la classe s’applique également aux élèves des cours préparatoires et vise, d’une façon plus générale, l’ensemble des élèves de l’école primaire.” Circulaire 17 décembre 1964
En 1994, lors de la création des études dirigées, les précédents textes sont remplacés par ce qui suit
“Organisées et conduites par le maître, pour tous les élèves de sa classe, les études dirigées renforcent les activités d’enseignement et favorisent l’apprentissage du travail personnel. Elles contribuent à apporter à chaque élève l’aide personnalisée dont il a besoin, permettant ainsi de prévenir les risques d’échec et de réduire les difficultés provenant des inégalités des situations familiales.
(…) Dans ces conditions, les élèves n’ont pas de devoirs écrits en dehors du temps scolaire. À la sortie de l’école, le travail donné par les maîtres aux élèves se limite à un travail oral ou des leçons à apprendre.” Circulaire n° 94-226 du 6 septembre 1994, (B.O. n° 33 du 15 septembre 1994)
Lors de promulgation des programmes de 2002, il est précisé que les études dirigées ne disparaissent pas ” mais une autonomie supplémentaire est laissée aux maîtres pour utiliser cette pratique en fonction des besoins particuliers d’une classe tout au long de l’année ou pendant une période déterminée. ”
Enfin, dans le socle commun sorti en 2015, il est indiqué dans le Domaine 2 – les méthodes et outils pour apprendre : « Les méthodes et outils pour apprendre doivent faire l’objet d’un apprentissage explicite en situation, dans tous les enseignements et espaces de la vie scolaire. » sans parler explicitement des devoirs à la maison, ce texte invite les enseignants à mettre en place en classe les pratiques développant les méthodes d’apprentissage.
Il est donc clair à la lecture de ces textes officiels, que dès le CP, les devoirs écrits sont exclusivement faits en classe et que les devoirs du soir ne concernent qu’un travail oral ou l’apprentissage des leçons.
Pourtant, nombreux sont les enseignants qui donnent des devoirs écrits aux élèves. Alors fausse interdiction légale ? Obligation ou pression sociale ? Il est important de se donner quelques principes pour que l’activité soit la plus pédagogique possible c’est-à-dire qu’elle accompagne l’élève dans ses apprentissages.
- Des principes
Dans un premier temps, il est indispensable de préciser la place de ces devoirs dans l’apprentissage. En aucun cas, ils ne remplacent le travail de la classe. Ils ne sont pas faits pour rattraper ce qui n’aurait pas eu le temps d’être fait en cours. Ils peuvent permettre de reprendre ce qui a été appris en classe, de se réapproprier une méthode, de se redire ce qui a été vu précédemment.
Ils sont parfois une feedback pour les parents lorsque l’enfant relit un texte abordé dans la journée, explique avec ses mots une leçon rédigée en cours. Ils peuvent aussi servir à « l’entretien » de tâches répétitives comme apprendre une table. Lorsqu’un travail est demandé le soir, le plus gros du chemin a été fait en classe.
D’autre part, le travail du soir demande une véritable organisation de la part de l’élève. C’est l’occasion de développer la capacité de l’élève à apprendre, de préciser des méthodes de travail ou des démarches d’apprentissage, d’aider à l’organisation. Apprendre s’apprend ! Cela passe d’abord par un travail en classe d’explicitation, d’entrainement, d’’interaction entre élèves avant de laisser l’enfant seul face à ses devoirs. « Il faut s’interdire de renvoyer systématiquement à la maison des tâches pour lesquelles aucun mode d’emploi précis n’a, auparavant, été donné et travaillé en classe. »Philippe Meirieu « devoirs à la maison »
Enfin, le travail du soir n’est pas un supplément indéfini, imprécis, à la pratique de classe. Ses objectifs sont précisés et la cohérence dans l’équipe est indispensable Il n’est pas superflu de se poser la question des devoirs du soir en concertation pour apporter une réponse harmonieuse qui tienne compte du temps passé, de la place des parents dans ce travail, des réalités sociales vécues par les élèves, du retour de ce travail en classe (suivi, vérification, correction, récitation, …) de la possible différenciation en lien avec celle mise en place en classe…
Si l’on pense que ces devoirs du soir peuvent avoir un effet sur l’apprentissage, il est indispensable de les préciser pour en faire un outil au service de sa pédagogie. Cette précision permettra d’éviter bien des dérives trop souvent rencontrées.
- Des dérives
Par définition, le travail à la maison se fait sans l’enseignant, ce qui signifie que l’élève ne peut pas bénéficier de la guidance d’un professionnel de l’apprentissage. Les parents ne sont pas des enseignants, ne leur donnons pas ce rôle. C’est parfois, un lieu de malentendu, de cristallisation, de conflits lorsque les parents se chargent de remplacer l’enseignant. Les devoirs du soir devraient permettre une communication entre les parents et leurs enfants.
Il est rare que les devoirs à la maison se fassent à plusieurs. Et pourtant, on sait bien aujourd’hui l’importance de l’interaction, de l’entraide, de l’échange dans la compréhension, la construction d’un apprentissage. Ne comptons pas seulement sur le travail donné le soir pour s’assurer d’un apprentissage. Organisons en classe ces interactions qui favorisent la prise de conscience, la verbalisation, indispensable à l’apprentissage.
Les élèves ont déjà 6h de classe dans la journée. Pour certains c’est largement suffisant et donner du travail le soir est un excédent lourd à assumer. Le travail du soir alourdit la charge des enfants qui ont besoin de temps pour des activités sportives ou culturelles, pour se reposer ou simplement flâner. D’autres part, les contextes familiaux, sociologiques ou psychologiques sont très hétérogènes et créent des inégalités devant le travail dont il est difficile de tenir compte lors de la vérification du matin.
Enfin, lorsque les devoirs sont donnés, ils sont attendus le lendemain. Pour certains élèves, le but est de montrer qu’on a travaillé quitte à tricher pour cela. Le travail est fait vite, dans la cour, dans le bus ou la voiture, le matin avant de rentrer, par les parents… L’objectif n’est pas d’apprendre mais de montrer qu’on a fait. Le travail du soir devient un objectif en soi (il faut le faire) là où il devrait être seulement un moyen (il m’aide à apprendre)
L’enseignant ne maitrise que ce qu’il donne et ce qu’il récupère. Mais il ne maitrise pas ce qui se passe entre les deux. Il est essentiel de définir les objectifs de ce travail, d’en expliquer aux enfants et à leurs parents le fonctionnement, les libertés données … et surtout, il faut éviter de multiplier les heures de travail à la maison.
- Des exemples
Une petite enquête rapide nous a permis de répertorier, chez des enseignants, des exemples de modalités, ou d’outils mis en place dans leur classe. Cette liste est loin d’être exhaustive et pourra s’enrichir des expériences de chacun.
- Transfert des apprentissages :
- En classe on apprend et à la maison on utilise. C’est ce qui pourrait définir cette proposition d’un enseignant qui en début d’année distribue aux parents une liste des activités quotidiennes qu’ils peuvent faire avec leurs enfants pour utiliser ce qu’il a appris en classe (un travail d’écriture et de lecture : se faire une liste de course et aller chercher les produits dans le magasin ; un travail sur le budget donner une somme d’argent pour acheter ce qui est sur la liste, choisir un programme de télé en fonction de l’heure, ou un spectacle qu’il a envie de voir…)
- En classe on travaille et à la maison on joue. C’est ce que permet cette liste de jeux de société distribuée à la rentrée aux parents. Une liste où sont répertoriés plus d’une vingtaine de jeux de société auxquels sont associées les compétences utilisés lorsque l’enfant joue (compétence de lecture, de mémorisation, de calcul …
- Communiquer aux parents
- Une fiche explicative, donnée aux parents pour préciser les objectifs des devoirs à la maison, le rôle des parents, la place de l’écrit, des conseils pour mémoriser, des idées pour faire apprendre un poésie, ou des questions à poser pour apprendre une leçon …
- Un cahier tenu par l’élève dans lequel il écrit ce qu’il a appris et qu’il apporte à la maison
- Mettre l’élève en projet
- Sur le cahier de texte ne sont pas écrits seulement les révisions mais également les prochains apprentissages de la semaine pour permettre à l’élève de chercher des documents, de reprendre ses cahiers de l’année précédente, de se mettre en projet pour apprendre …
- Le ticket de révision : en lisant cette leçon je cherche quelle question on pourrait me poser. les questions des élèves seront posées le lendemain en classe.
- Une aide à l’apprentissage
- Une fiche méthodologique qui répertorie les conseils donnés pour apprendre une leçon, une table, préparer une lecture à haute voix …
- Un tableau d’aide à l’organisation lorsque le travail est donné pour la semaine, où l’élève indique son programme, le temps estimé et passé, la chronologie …
- Classe inversée
- De plus en plus de classes de cycle 3 mettent en place le principe de la classe inversée…
- Une pratique pédagogique venue des pays anglo-saxons possible avec les outils numériques qui peut être une pédagogie active où l’élève développe son autonomie en étant plus acteur de ses apprentissages.
- Il ne s’agit pas de remplacer le « cours magistral » fait en classe par une « vidéo magistrale » vue à la maison et cette pratique demande à être réfléchie avant d’être utilisée
- …
Le travail à la maison n’est pas la dernière roue de la pédagogie, qu’on organise un peu rapidement pour compléter le travail fait en classe et donner le change aux parents. Il est important que les enseignants se questionnent sur cette activité, comment l’organiser, la définir et lui donner une véritable légitimité.
Aujourd’hui de nombreuses sociétés privées se chargent du travail après la classe mais elles ne s’adressent pas à tous les élèves. L’école si !



